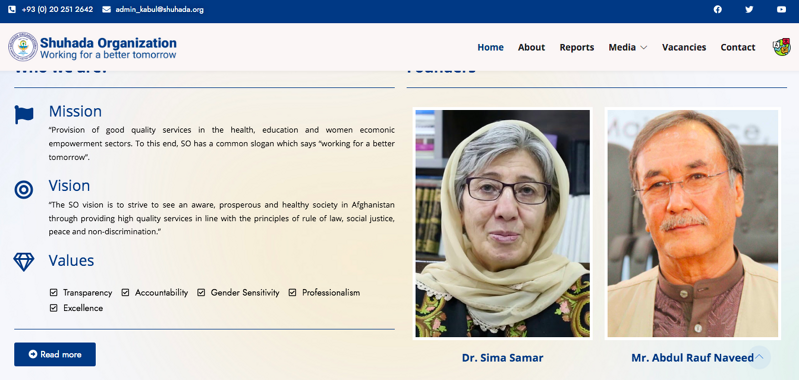MARTYR, -YRE, subst. Étymol. et Hist. 1. a) Ca 1050 «celui qui a souffert
la torture et la mort pour attester la vérité de la religion chrétienne»
(Alexis, éd. C. Storey, 566); 1690 (Fur.: Martyr, se dit abusivement des
Hérétiques et des Payens qui souffrent pour la défense de leur fausse
Religion); b) 1176-81 fig. (Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la
Charrette, éd. M. Roques, 4689); 2. 1690 «celui qui souffre beaucoup
moralement ou physiquement» (Fur.); d’où 1694 (Ac.: On dit fig. qu’une
personne est le martyr d’une autre pour dire qu’il souffre persecution à
cause de luy). Empr. au lat. eccl. martyr, du gr. μ α ́ ρ τ υ ς, -υ ρ ο ς
«témoin», d’où spéc. «témoin de Dieu, martyr». Au Moy. Âge, on trouve
également la forme martre (v. T.-L. et Gdf.) forme conservée dans
Montmartre «mont des martyrs».
Shahid
Étymologiquement, le mot chahid provient des lettres radicales sh. h. d.
lesquelles signifient la présence, le savoir et l’acte d’informer. Sa forme
admet, selon les grammairiens, deux possibilités : d’être le nom actif
(fâ’il) ou le nom passif (maf’ùl). Dans le premier cas, Shahid est
l’intensif de shahid dont le sens général est d’être témoin.
Ainsi, dans l’Islam, la racine sh. h. d. est dans la profession de foi :
shahada, qui est l’acte par lequel le musulman atteste (ashhadu) qu’il n’y
a de Dieu que Dieu et que Mohamed est son prophète. Le martyr (chahid) est
celui qui est mort d’avoir porté le témoignage
“Salutations de la part du nationalisme, de la patrie et de la libération
arabes, Si tu lis ceci, cela veut dire que je suis mort et que mon âme est
montée vers son créateur. Je prie Dieu de pouvoir le rencontrer avec un
cœur innocent, de mon plein gré, jamais à contrecœur et libre de toute
trace d’hypocrisie. Qu’il est difficile d’écrire son propre testament…
Depuis des années, je vois ce genre de textes rédigés par des martyrs et
cela me déconcerte. Brefs et sans éloquence, ils ne satisfont pas notre
brûlant désir de réponses au sujet du martyre. Maintenant, je suis en route
vers ma mort, satisfait d’avoir trouvé mes réponses. Quel insensé je suis !
Y a-t-il quelque chose de plus éloquent que les actions d’un martyr ?
J’aurais dû écrire ceci il y a des mois mais ce qui m’en a empêché, c’était
que cette question était pour vous, les vivants. Pourquoi devrais-je
répondre à votre place ? C’est vous qui devriez chercher la réponse. Quant
à nous, les gens des tombes, nous ne cherchons rien d’autre que la
miséricorde de Dieu.” extrait de
+++++++
La rue Al-Shuhada, en arabe https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe : شارع
الشهداء signifiant littéralement en français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais : rue des Martyrs (Chahids
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chahid), surnommée *rue de l’apartheid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apartheid_isra%C3%A9lien* par les
Palestiniens https://fr.wikipedia.org/wiki/Palestiniens et *rue du roi
David https://fr.wikipedia.org/wiki/David_(roi_d%27Isra%C3%ABl)* par
les colons
israéliens https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonies_isra%C3%A9liennes, est
une rue https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue bordée de commerces fermés qui
conduit du centre de la Vieille ville d’Hébron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille_ville_d%27H%C3%A9bron en Cisjordanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cisjordanie occupée au tombeau des
Patriarches https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombeau_des_Patriarches. Les
seuls Palestiniens qui peuvent entrer dans la zone sont les propriétaires
de maisons, et ils ne peuvent le faire qu’à pied - depuis 2010. Seules les
voitures israéliennes peuvent emprunter l’axe, ainsi que les colons
israéliens et les touristes.
Après les émeutes qui ont suivi le massacre du tombeau des Patriarches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_d%27H%C3%A9bron_(1994), par un colon
israélien https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonies_isra%C3%A9liennes en février
1994, Israël ferme la rue aux Palestiniens. Au début des années 2000,
conformément au protocole d’Hébron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_d%27H%C3%A9bron, la rue est
rouverte à la circulation des véhicules arabes. Les magasins sont toutefois
restés fermés. La rue est à nouveau fermée aux Palestiniens après les
violences de la Seconde intifada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_intifada.
Après la fermeture de tous les magasins palestiniens, des bureaux
municipaux et gouvernementaux palestiniens ainsi que de la gare routière
centrale, qui est devenue une base de l’armée israélienne, la zone de la
rue Al-Shuhada devient pratiquement une ville fantôme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_fant%C3%B4me. Les marchés de légumes
et de gros situés à côté de la colonie d’Avraham Avinu deviennent une zone
interdite aux Palestiniens. Une manifestation internationale annuelle « Open
Shuhada Street » (Ouvrez la rue Shuhada) est organisée depuis 2010.
Noms
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shuhada_Street_apartheid.jpg?uselang=frLa
rue Al-Shuhadan avec des magasins palestiniens fermés en 2010. Le passage
des Palestiniens est interdit, et seuls les résidents, les colons
israéliens et les touristes sont autorisés à y passer[1]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_note-1.
Bien qu’il n’y ait pas de panneaux officiels, la rue al-Shuhada est le nom
officiel de la rue, signifiant rue des Martyrs. Les Israéliens l’appellent
rue du roi David. En 2011, les Palestiniens l’ont temporairement renommée *rue
de l’Apartheid*[2]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_note-Maan-2. Rafiq
al-Jabari, collaborateur du gouverneur d’Hébron, explique que ce changement
restera en place « jusqu’à la fin de la ségrégation de l’apartheid qui est
appliquée par les colons sous la protection des soldats de l’occupation »[2]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_note-Maan-2.
Historique
Après l’occupation israélienne d’Hébron en 1967, un certain nombre de
colonies sont établies à l’intérieur et autour de la ville. La première
colonie, Kiryat Arba, est créée en 1968 près dutombeau des Patriarches,
situé à quelques centaines de mètres au nord de la rue Al-Shuhada. Sarah
Nachshon, l’épouse du fondateur, créé une autre colonie dans un poste de
police de la rue Al-Shuhada en 1979[3]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_note-3.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012.02.02.1.Hebron.JPG?uselang=frTag
au milieu de la rue : rue de l’appartheid.
Notes et références
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_ref-1 (en) Ayelet
Waldman, « The shame of Shuhada street », The Atlantic, 12 juin
2014 (lire
en ligne
https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/06/the-shame-of-shuhada-street-hebron/372639/
[archive
], consulté le 27 novembre 2024).
- ↑ Revenir plus haut en :a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_ref-Maan_2-0 et b
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_ref-Maan_2-1
(en) « Hebron
road renamed “Apartheid Street” », Ma’an News Agency [lien archivé], 15
septembre 2011 (lire en ligne
https://web.archive.org/web/20111102190205/http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=420542,
consulté le 28 novembre 2024).
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Al-Shuhada#cite_ref-3 (en) Jeffrey
Goldberg, « Among the Settlers », The New Yorker, 24 mai 2024 (lire
en ligne
https://www.newyorker.com/magazine/2004/05/31/among-the-settlers?currentPage=2
[archive
], consulté le 29 novembre 2024).
Articles connexes
- *Hébron, Palestine, la fabrique de l’occupation
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9bron,_Palestine,_la_fabrique_de_l%27occupation*
- Voie des adorateurs
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Voie_des_adorateurs&action=edit&redlink=1
(en) <https://en.wikipedia.org/wiki/Worshippers_Way>
+++++
https://www.humanite.fr/monde/palestine/chronique-dhebron-open-shuhada-street
+++++
[image: Screen Shot 2025-07-07 at 19.15.35.png]
TEXTE EN ENTIER EN-DESSOUS:
Basil Al Araj : « Pourquoi partons-nous en guerre ? »
5 FÉVRIER 2023
En avril 2016, Basil al-Araj
été arrêté et emprisonné par l’Autorité palestinienne avec quatre autres de
ses camarades. Détenu et torturé pendant plusieurs mois, ils avaient été
accusé de préparer des opérations armées contre l’occupation. Libéré après
une grève de la faim, il est poursuivi et recherché par les services
sionistes. Ainsi, il entrera dans la clandestinité pendant près d’un an.
Il a été assassiné le 6 mars 2017 lors d’un affrontement armé avec les
unités spéciales sionistes à l’intérieur d’une maison qu’il barricadait à
Ramallah, après près d’un an dans la clandestinité.
Trouvez ici l’article publié par JISR Collective, le 29 janvier 2023
« Je vais bien. Je me sens un peu seul et à l’écart, comme d’habitude. La
solitude me semble devenue si familière qu’elle ne m’est plus étrangère.
Les décisions difficiles requièrent fermeté et confiance en soi, mais je
puis vous dire quelque chose qui vous soulagera d’une partie de votre
douleur, et le problème est à coup sûr la douleur. Essayez de vous rappeler
que votre crise existentielle a réellement trait à une cause sublime, plus
grande que tout autre conflit, et laissez ce problème en votre esprit vous
aider à la surmonter. Que la Palestine soit devant vos yeux. »
Le martyr Basil Al-Araj
[image: Basil Al Araj]
Le texte qui suit est un essai rédigé par *« l’intellectuel révolutionnaire
»* et martyr Basil Al-Araj
Nous nous souvenons de Basil. Basil faisait le tour de l’assistance et d’un
humble signe de tête saluait les personnes présentes mais, quand il prenait
la parole, l’incontestable vérité de ses propos résonnait fortement et
captait tous les regards. Il insufflait du courage à nos cœurs brisés quand
nous voyions la catastrophe de l’USAID et de l’enclave de la normalisation
à Ramallah qui consumait et manipulait notre peuple. La très lâche Autorité
palestinienne ne pouvait pas débattre avec Basil. Tout ce qu’elle pouvait
faire, c’était tenter de le réduire au silence. Et même là, elle a échoué.
Basil maintient la Palestine devant nos yeux et continue d’anéantir les
ennemis perfides. Ce n’était pas un réactionnaire, mais un bon enseignant
qui nous montrait le contexte nous permettant d’en arriver à la seule
conclusion que devrait atteindre un peuple sous occupation : La libération
se trouve sur le chemin de la vérité. Il n’y a pas de place pour le
mensonge quand les murailles et les check-points nous étouffent.
Ses mots vivent ici et partout et, pour nous qui avons partagé le thé avec
lui et poussé de profonds soupirs sous les nuages de l’occupation, ses mots
vivent dans les traces solitaires de notre exil comme une leçon et une
pratique de défense. Aussi gênants pour les institutions du pouvoir que
nous soyons tout en nous y opposant, nous devons prendre la parole. Basil a
voulu mourir pour libérer la terre et les esprits.
L’Autorité palestinienne de la normalisation a traqué Basil et a joué un
rôle significatif dans sa coordination avec l’ennemi en vue de réduire
Basil au silence. Ils haïssaient la façon dont Basil enseignait la
résistance.
Basil a accédé au martyre au cours d’une fusillade de plusieurs heures
déclenchée par les sionistes au camp de réfugiés de Qaddoura, non loin du
centre de la ville de Ramallah où, dans un passé révolu, c’étaient les
traîtres que l’on pendait. Aujourd’hui, ce sont les traîtres qui dirigent
les exécutions de révolutionnaires et, en retour, ils se voient accorder
des paquets d’aide du Congrès en guise de primes.
À côté de Basil, il y a ses fameuses lunettes, son keffieh et ses écrits,
dont son testament. Ses écrits ont été rassemblées en un livre, *« J’ai
trouvé mes réponses »* (une phrase tirée de son testament), publié à titre
posthume.
Dans le présent essai, Basil demande à son cher ami, resté non identifié, *«
Pourquoi partons-nous en guerre ? »*. En entremêlant l’histoire, la
physique, la philosophie, le cinéma et la mythologie, il arrive à une
réponse : le romantisme.
*****
Pourquoi partons-nous en guerre ?
Mon cher ami,
À partir de ce jour, je vais écrire pour toi. J’écrirai avec
l’émerveillement des enfants et avec la foi des prophètes, et jamais je ne
serai embarrassé à propos de ce que j’aurai écrit. Si je vis, je
découvrirai soit les rêves des enfants et leurs fantaisies, soit les
visions des prophètes et ce que j’aurai écrit ici ne me nuira jamais si je
viens à mourir.
Toi, mon ami, tu es quelqu’un de très diversifié. Parfois, je te perçois
comme quelqu’un de masculin et, en d’autres temps, de féminin. Parfois je
te perçois comme un frère d’armes et de lutte ; en d’autres temps, je te
vois plutôt comme un opposant politique. Parfois, je te vois comme l’un de
mes grands professeurs ; en d’autres temps, tu es l’un de mes amis. Car
toi, mon ami, n’es rien de moins que tous ceux que j’ai connus. Quoi qu’il
en soit, chaque lettre représentera un dialogue entre moi et l’un ou
l’autre ami, un camarade, ou un professeur et, parfois, peut-être, le
dialogue se fera avec plus d’une personne.
Sais-tu quand je crée le plus intense de mes monologues, dans cette
solitude qui est la mienne ? C’est quand je commence à tomber à court de
cigarettes et, ce soir, mon ami, il ne m’en reste qu’une demi-douzaine et,
ainsi donc, laisse-moi te raconter ce qui m’occupe l’esprit.
***
Mon cher ami,
Je ne sais pas vraiment pourquoi je me mets à réfléchir chaque fois que je
tombe à court de cigarettes, mais je me rappelle comment l’un de mes autres
amis me décrivait comme un* « primitif ».*
Te souviens-tu, mon cher, de ce que je t’ai dit un jour ?
« La ville nous tuera tous deux. Ma haine pour elle et mon désir d’échapper
à son urbanisation me tueront, et tu seras tué par ta convoitise sans fin
de la ville et de son urbanisation. »
Quoi qu’il en soit, j’ai trouvé un certain humour dans l’explication
concernant mon primitivisme et mes cigarettes. Un explorateur demandait un
jour à un Inuit : « Qu’est-ce qui vous occupe l’esprit ? » et l’Inuit lui
répondit :* « Je n’ai pas besoin de penser. J’ai assez de nourriture pour
l’instant. »* L’Inuit se met à faire fonctionner son esprit quand il tombe
à court de nourriture, et c’est également le cas pour moi quand je commence
à tomber à court de cigarettes.
Il est regrettable que bien des choses que j’ai dites aient été prises au
sérieux, et même mes absurdités et les plaisanteries sur le féminisme, par
exemple. Tu trouveras toujours quelqu’un qui les prendrait au sérieux et se
mettrait à en discuter, de sorte que j’estime qu’il est de mon devoir ici
de dire que, malheureusement, je n’ai pas de prétention à la vérité et ne
la cherchez donc pas ici et remettez en question tout ce que je dis, même
si je le dis avec un cœur débordant de la foi des prophètes. Faites plutôt
de la place pour la réflexion, même si je formule mes pensées en termes et
en vocables enfantins. Comme le disait Ali Al-Wardi :
« Rien de ce qu’a inventé l’esprit humain n’est plus horrible que
l’intrigue de la vérité et de la réalité. »
Par conséquent, ici, je ne revendiquerai ni la vérité ni la réalité, car je
suis la doctrine de notre professeur, qui disait :
« La vérité n’est rien d’autre que le chemin que vous empruntez dans votre
voyage en quête de la vérité. »
***
Mon cher ami,
Pourquoi partons-nous en guerre ? Bien sûr, c’est une question qui me hante
quand je suis seul et je crois que cette question est la même pour toute
l’humanité. Cette question, dans le monde adulte, équivaut à demander aux
enfants comment ils sont venus en ce monde. Permets-moi de me libérer de la
quête d’élégance dans les mots ou dans le flux des idées, et laisse-moi me
libérer aussi des généralisations ou des particularités. Cette question
m’accompagne depuis plus de vingt ans. J’ai cherché sa réponse dans les
profondeurs de certains livres et dans les cœurs et esprits de certains
professeurs. J’ai cherché sa réponse dans les biographies des héros et des
martyrs car toi, mon cher ami, tu sais que sa réponse est directement liée
à la question de l’héroïsme et du martyre. Finalement, j’ai découvert que
je ne suis pas le seul à être déconcerté par cette question, mais que
presque tous ceux que je connais, amis ou ennemis, le sont. Comme tu le
sais, la littérature de* « contre-insurrection »* bourdonne littéralement
de cette question.
Cela fait peut-être huit mois que ma vie a entamé son propre cours, depuis
ma première disparition, ensuite mon emprisonnement, et ici nous sommes au
milieu de ma seconde disparition. Depuis ces jours-là, certaines choses ont
commencé à se révéler à moi-même et je n’en connais pas la raison. Est-ce
de l’expérience et/ou de la crainte, de l’anxiété et/ou une clarté d’esprit
et la dévotion – je n’en connais pas la raison exacte, ni même si c’est une
hallucination, des hallucinations venant de la solitude ? Est- ce une
rupture avec la réalité ou un choc abstrait avec la réalité ?
As-tu lu le poème d’Omar Al-Farra, *« Les hommes de Dieu le jour de la
conquête du Liban »* ? Il suit les traces de ces hommes et ainsi donc, à
l’instar d’Omar Al-Farra, j’ai cherché et suivi la voie de ces mêmes
hommes, la géographie de l’héroïsme, du martyre, et l’histoire du sacrifice
personnel. Oh Dieu, comme je suis humble quand je marche à travers ces
montagnes et que je descends dans ces vallées ! Il n’y a pas de comparaison
avec mon humilité quand je suis ici, même en prière. J’ai cherché une
réponse à cette question au cours d’un voyage qui m’a pris vingt ans. Je
cherche « la vérité et les visages manquants », dirait de moi mon
professeur.
Maintenant, revenons-en à la question.
***
Mon cher ami,
Pourquoi partons-nous en guerre ?
Un jour, tu m’as posé la question :
« Qu’y a-t-il d’incorrect lorsque la motivation pour la lutte est une
motivation individualiste, personnelle ? »,
alors que tu exprimais une objection à un certain article de journal. Ce
n’est pas important. Ce qui était important, ce jour-là, c’est que tu m’as
parlé de l’histoire de la cellule de Jasser Al-Barghouthi, ce jeune homme
qui commandait l’une des cellules les plus importantes de Cisjordanie au
cours de la Seconde Intifada. Tu m’as dit qu’il avait décidé d’effectuer sa
première opération parce qu’il avait été giflé au visage par un soldat à un
check-point. Bien que j’aie gardé des traces de tout ce qui a été publié
sur cela depuis lors, et bien que je sache que la création de la cellule
n’avait pas été motivée par cette gifle, je n’ai jamais cessé d’y repenser
et je t’ai toujours redemandé de me raconter l’histoire de cette cellule,
même si j’en savais plus que toi à ce propos. Le pourquoi de la chose,
c’est que j’aimais ton récit bien davantage que la version officielle à
propos de Jasser Al-Barghouthi et, ainsi donc, ce n’est pas la gifle qui a
déterminé les choix de l’homme. Ton récit a allumé mon imagination, pour le
dire avec les mots de notre ami poète.
Arrêtons-nous ici et jetons un coup d’œil sur tous les récits connus dans
l’histoire et qui ont impliqué l’héroïsme, le martyre et le sacrifice
personnel. Les récits du monde entier, y compris ceux de nos ennemis, ont
un dénominateur commun. La question qui surnage est celle-ci : pourquoi
partons-nous en guerre ? Les motivations, le devoir, le patriotisme, la
volonté d’échapper aux ennuis, les croyances religieuses ou de classe, la
dualité du bien et du mal, du droit et du vice, de la vengeance et de
l’avidité ? Il est possible que toutes ces motivations existent. Mais elles
ne sont pas ce qui rend toute l’histoire de l’humanité si semblable, car
chaque dogme de foi a en face de lui un autre dogme qui le contre, car
chaque ligne de patriotisme a en face d’elle une ligne qui l’annule, etc.
Ainsi donc, pour chacune de ces motivations, il en existe une qui la contre
ou l’annule de l’autre côté de la bataille.
Et tu comprends, mon ami, qu’en pratique, il n’y a pas d’idéologie
révolutionnaire, ni d’idéologie conservatrice réactionnaire. Pas plus qu’il
n’y a de religions, de lignes ou de courants qui suivent la même
dichotomie, ni même de nationalités ou d’identités ou de structures
populaires. Toutes ces choses portent en elles une opposition intrinsèque.
Et ce n’est rien de plus qu’une interprétation. Je te conseille de lire ce
qu’on a écrit sur les batailles des Castillans contre les musulmans
andalous. Tu verras que tu auras l’impression de lire un récit qui t’est
familier et qui provient des Conquêtes islamiques : une histoire de cette
faible minorité effrayée et à peine armée qui s’est tournée vers Dieu dans
les profondeurs des nuits, en pleurant et en implorant pour avoir la
victoire et, une fois le soleil levé, ces mêmes hommes étaient devenus des
chevaliers et ils se retournèrent sur leurs nombreux et puissants opposants
dans une violente attaque qui se termina par la défaite de ces mêmes
opposants ; toutes les histoires impliquant un héroïsme patriotique,
nationaliste, de classe ou religieux suivent la même ligne.
***
Mon cher ami,
Mon grand-père me parlait souvent de l’histoire de la révolution druze
contre les Turcs. L’élément déclencheur de la révolution fut un verset
d’Ataaba (1)et, bien que j’aie été au courant des « faits » historiques
concernant cette révolution, j’ai toujours été étonné par le récit de mon
grand-père.
Prenons, par exemple, les récits de l’ennemi concernant leurs propres
héros. Fais abstraction des noms et des parties combattantes et écoute le
récit. Tu vas t’y retrouver engagé. Mon ami, puisque tu t’intéresses au
cinéma, prends, par exemple, le film « Nous étions soldats », avec Mel
Gibson. En dépit de notre sympathie entière et inconditionnelle pour les
Vietnamiens, nous sommes définitivement tombés amoureux du personnage de
Mel Gibson et de son héroïsme. Quoi qu’il en soit, compare cela aux films* «
The Patriote : le chemin de la liberté »* et « Braveheart », avec le même
acteur.
***
Mon cher ami,
Mes excuses si j’allonge ainsi la question. Pourquoi partons-nous en guerre
? Nous y allons à la recherche de romantisme. Le romantisme de la guerre,
qui crée un nouveau type d’humain, car personne ne reste le même après
avoir vécu une guerre. Nous pourchassons ce romantisme et rien n’attise
plus le romantisme que la guerre.
Je te recommande de lire un livre intitulé « Mémoires de soldats ». Ce
livre m’a étonné et m’a informé sur des choses que je ne pouvais exprimer
précédemment en langage humain. Peut-être la langue ne t’a-t-elle jamais
manqué, à toi ou à notre ami poète et, de ce fait, tu ne sauras jamais ce
que c’est que d’être incapable d’exprimer ses pensées.
Il est vrai que nous allons à la guerre pour y chercher du romantisme et
peut-être étais-je honteux d’admettre cela en moi-même. Tu sais à quel
point ce terme a pu se muer en cliché. Je m’enfuyais de ce romantisme
chaque fois qu’il essayait de m’emporter et j’essayais de bien comprendre
toutes ces motivations. Nous sommes trop arrogants pour admettre cette
raison, mais nous savons tous que ce qui nous pousse vers l’héroïsme et le
martyre est la même chose que nous sommes si honteux d’admettre : le
romantisme.
Rétroactivement, je suis retourné à ce que j’écrivais à propos des
biographies de ces héros et, avec le recul, je n’ai pu que constater que je
l’avais admis tout le temps sans le savoir – c’est-à-dire que nous étions
en quête de romantisme – par le biais du langage que j’utilisais pour
écrire. Laisse-moi te dire aussi, même si aujourd’hui je crois plus que
jamais en l’absurdité de vouloir coucher des mots sur papier, je le fais
toujours en cet instant en me servant du romantisme comme motivation : la
pensée de voir ton sourire ou tes larmes (et je sais que tu ne verses plus
de larmes), la pensée d’une larme ou d’une émotion exprimée par quelqu’un
qui lit cela, la pensée d’entendre un mot de louange, etc. C’est ce qui me
motive à écrire. Et, ainsi, toutes les autres tentatives en vue d’expliquer
ou de trouver une réponse à la question ne sont en elles-mêmes pas des
réponses, mais des échappatoires à la réponse ; elles constituent une
tentative de rationalisation du romantisme.
Nous découvrons et expliquons le moment précis où interviennent ces
motivations. On ne peut répondre à la question *« pourquoi suis-je ici
? »* excepté
via des motivations patriotiques, religieuses, nationalistes et
personnelles, etc., mais je puis visionner le passé à travers la lentille
du romantisme et je puis voir le futur de cette façon aussi. Peut-être cela
s’explique-t-il du fait que le romantisme n’existe pas en premier lieu ;
peut-être n’est-ce qu’un mirage que nous sommes condamnés à pourchasser à
jamais. Nous le voyons lorsque nous regardons vers l’avant, de sorte que
nous le pourchassons de nouveau, uniquement pour découvrir qu’il nous
échappe. Et, au moment où, finalement, nous mettons la main sur le
romantisme, il s’avère qu’il n’est rien de plus que quelques traces, ou
quelques éphémères instants de contemplation qui se terminent rapidement
avant que le monde matériel ne nous soumette à nouveau à notre propre
réalité.
Le romantisme s’écroulera devant nos yeux dès l’instant précis où nous nous
mettrons à marcher sur la voie censée nous mener à lui ; il s’évaporera
entre nos doigts comme fumée à l’instant même de notre première collision
véritable avec la réalité.
Et laisse-moi te dire que mon romantisme pour la guerre s’est évanoui dès
mon premier pas dans les montagnes et, pourtant, je continuais à le voir en
face de moi. J’aurais couru après lui, je l’aurais pris au piège et
j’aurais tenté de l’attraper alors qu’il m’attirait toujours vers le bas
et, malgré tout cela, ces quelques jours furent les plus beaux moments de
mon existence. Comme nous le disons dans notre dialecte : *« On ne peut
trouver la gloire qu’au sommet des montagnes »* et, alors que nous étions
en prison, nous y avons ajouté ceci : *« On ne peut trouver la gloire qu’au
sommet des montagnes et on ne peut trouver les montagnes que dans la
poitrine des hommes. »* Et, une fois encore, nous avons découvert qu’en
prison nous suivions le même modèle de poursuite du romantisme. Et, ainsi
donc, savez-vous ce qu’est l’espoir ? C’est la poursuite rapide de ce
romantisme et la croyance que vous allez mettre la main dessus. J’atteins
mon moment quand j’attrape le besoin de tousser et que la fumée de
cigarette m’aveugle les yeux. Et c’est là que mon romantisme s’échappe une
fois de plus, mais seulement pendant le temps qui m’est nécessaire pour le
retrouver plus tard. Le fait de donner des cours en prison sur l’*«
histoire moderne de la Palestine »*, et le désir d’expliquer cette histoire
afin de trouver une réponse logique rationnelle, m’ont aidé, et d’autres
aussi, à supporter la douleur de la prison. Toutes ces tentatives en vue
d’expliquer la chose n’ont rien fait sauf me conférer une vision claire du
chemin qui mène à une oasis de romantisme.
Maintenant, passons à l’histoire de notre amie gazaouie qui était en
randonnée dans les vallées d’Al-Rad et de Naplouse, lors de sa première
expérience dans les montagnes. C’était la première fois qu’elle se rendait
dans des zones rocheuses. Quelques jours avant la randonnée, je lui avais
demandé ses impressions à propos des montagnes. Ses impressions étaient
purement romantiques. Le jour de la randonnée, tous ses os s’étaient
presque disloqués. Elle s’était totalement éloignée du romantisme qu’elle
avait recherché. Le lendemain, après avoir confirmé qu’elle se repentait
d’avoir grimpé, elle avait écrit le plus beau texte qui soit sur
l’expérience de la randonnée et elle avait rappelé l’histoire de l’héroïsme
et du martyre dont elle savait qu’elle était liée à la montagne. Quand elle
avait transposé son expérience en utilisant un temps passé, elle avait été
en mesure de voir le romantisme qui l’imprégnait.
Il me vient à l’esprit de demander : *« Qu’est-ce que le romantisme, avant
toute chose ? »*
Et je me retrouve comme tu m’as un jour décrit :* « Un homme de foi, sans
aucun doute. »* Je suis absolument certain que je n’ai nul besoin de
définir cela, aussi certain que Nazik Al-Malaika, la poétesse nationaliste
arabe, quand elle a dit que certaines choses que l’on ressent et vit ne
nécessitent pas de définition. Ainsi donc, je ne te demanderai pas son sens
ou ses racines linguistiques.
Et vous, les universitaires, vous vous efforcez toujours à éloigner la
magie des choses en les interprétant, en pensant que vous atteindrez la
vérité.
En ces jours de pluie, je te dirai que je n’ai nul besoin d’un cadre
explicatif pour expliquer la cause de la pluie, qu’il s’agisse du marteau
de Thor ou de la miséricorde d’Allah envers ses serviteurs, ou encore de
l’interprétation par la science du phénomène. Je n’en veux aucune ; je ne
veux que mon émerveillement constant et mon sourire stupide chaque fois
qu’il pleut, comme si c’était la première fois, l’expérience de
l’émerveillement des enfants et la magie du monde.
Pourquoi dis-je cela à propos des universitaires ? Je me suis souvenu de la
façon dont ils écrivaient l’histoire. Ils écartent tout romantisme de
l’histoire, si bien que la plupart des gens n’aiment pas lire de
l’histoire, même s’il est possible d’écrire l’histoire selon une
méthodologie qui préserve son caractère romanesque. Ce sont des outils
d’analyse simples et appropriés et une méthodologie historique sérieuse,
mais ils ne peuvent être pris au sérieux par tout autre universitaire s’ils
n’éloignent pas la magie des choses, la magie du romantisme.
Et, honnêtement, je ne sais pas pourquoi il y a cette hostilité de la
modernité à l’égard du romantisme. Sais-tu, par exemple, que les premières
applications pratiques de la chimie et de la physique modernes consistaient
à l’origine à ajouter de la magie aux choses ? Mais la modernité est
semblable à du poison dans du miel. Elle te donne l’illusion qu’elle veut
la magie, l’attrait et le caractère romanesque des choses, et une fois
qu’elle s’assure un contrôle ferme sur toi-même, elle te reprend tout cela.
Remarque, par exemple, les façons de s’y prendre de l’homme « primitif »
avec la technologie et le début de son savoir à ce propos. Remarque, par
exemple, à quel point les communications sans fil ont ravi nos esprits à
leurs débuts (je t’ai parlé de notre histoire avec le premier téléphone à
être entré dans notre quartier).
Pour commencer, tu vois la magie des choses. Puis, nous y voici, nous avons
emporté cette magie de toutes les choses et elle ne nous surprend plus.
Pourquoi avons-nous besoin du romantisme ?
Je dirais que, sinon pour l’un ou l’autre homme doté d’un tempérament
romanesque débridé qui n’est éloigné que d’un cheveu de la banalité,
l’histoire de l’humanité n’aurait été d’aucune importance méritant d’être
citée. Mon ami, imagine notre Prophète Mahomet (La paix soit sur lui !)
quand il était en fuite, pourchassé, effrayé et mourant de faim et,
pourtant, lorsqu’il fut rattrapé par Suraqa ibn Malik, il ne put rien faire
d’autre que de lui promettre toute la cavalerie de Khosrow II (le roi des
rois sassanide d’Iran). Si Suraqa avait été une personne moderniste,
rationnelle et réaliste, il aurait fermement entravé le Prophète, l’aurait
livré à la tribu de Quraych (la tribu au sein de laquelle est né Mahomet –
NdT) et obtenu sa récompense de cent chameaux. «* L’homme, tu es un fugitif
et Quraych, avec tous ses fous et ses maîtres, te pourchasse et toi, tu me
promets la cavalerie de Khosrow ? »* Mais, par bonheur, le sort avait mis
en présence de notre Prophète Mahomet quelqu’un comme Suraqa, doté d’une
vaste imagination, de rêves sauvages et d’un caractère romanesque assez
excessif pour prendre le Prophète au mot et le laisser aller. Je suis
certain que Suraka s’est fait traiter de « fou naïf » au moins une fois,
après cela.
Nous avons besoin de romantisme pour poursuivre notre existence. Je ne vois
pas comment, sans romantisme, nous pourrions survivre en tant qu’espèce.
Je vais te raconter quelque chose sur la guerre et le romantisme. Quand
Napoléon se rendit en Égypte, il fut surpris par les Mamelouks avec leurs
longues moustaches, leurs cimeterres, leurs vaisselles de verre et leurs
boucliers sur leurs chevaux. Ce n’est qu’un instant plus tard que les
balles et les canons de Napoléon jonchèrent le sol de cadavres de Mamelouks.
À l’époque, et jusqu’à tout récemment, la plupart des historiens, des
intellectuels et des auteurs décrivaient la mentalité des Mamelouks comme *«
primitive »* en comparaison avec celle du moderne Napoléon et ils
attribuaient aux Mamelouks une stupidité et une naïveté exagérées.
Mais je vois les choses selon une perspective différente. Je peux voir que
les Mamelouks étaient bien conscients de ne se trouver qu’à quelques
instants de leur anéantissement inéluctable et, pourtant, ils refusèrent
d’accueillir cet anéantissement les bras ouverts. Sais-tu ce que cela
représente, pour quelqu’un, d’être élevé durant toute sa vie selon les
valeurs de la chevalerie et de la bravoure ? Et, alors, quelqu’un s’amène
et essaie de leur dérober tout cela. Les chevaliers mamelouks le savaient
et ils refusèrent d’abandonner le romantisme des confrontations, de la
chevalerie, de la bravoure et de la mort.
En un autre lieu et des dizaines d’années après cet événement, un événement
similaire à celui des Mamelouks eut lieu. Il a été décrit dans le film* «
Le dernier samouraï »* et, quoi qu’il en soit, le soldat qui combattit aux
côtés du samouraï était un Français, et non pas un Américain. Le film
dépeint l’épopée de la dernière bataille et, de la même façon que dans la
bataille entre les Mamelouks et Napoléon, on peut remarquer le romantisme
qui émane de la scène décrivant la mort de Katsumoto.
Plusieurs décennies plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, les
deux tiers de l’armée britannique furent anéantis au cours des deux
premiers mois de la guerre. Tu sais pourquoi ? Les mémoires des officiers
anglais de l’aristocratie militaire britannique nous donnent la réponse.
C’est là qu’ils ont compris que la guerre telle qu’ils la connaissaient
était terminée et qu’à partir de ce jour il n’y avait plus la moindre
possibilité ni la moindre place pour les chevaliers et les braves. Après
que les Allemands les eurent fauchés de la même façon que leurs
mitrailleuses Maxim (la fierté de leur armée), ils comprirent là que c’en
était terminé pour eux. Toutefois, de nombreux membres de cette
aristocratie militaire ne voulurent pas abandonner le romantisme de la
guerre et de la chevalerie, et ce ne fut que pour s’en aller mourir au
cours de misérables missions suicides de la nature de l’héroïsme des
derniers affrontements, et ils allèrent donc à la mort avec tout leur
courage
Lors de la Première Guerre mondiale, les Européens savaient que la première
chose tuée par la modernité était le romantisme. Ainsi donc, qu’est-ce que
cela signifie de se trouver des mois durant dans une tranchée, avec la mort
qui vous attrape sans que vous puissiez regarder votre assassin dans les
yeux ou sentir le passage forcé de sa lame dans votre poitrine ? Là-bas,
ils étaient emportés par la mort, par les obus qui tombaient d’un ciel
qu’ils ne pouvaient guère voir, ou par les coups de sifflet d’un officier
qui leur ordonnait d’avancer d’un mètre pour mourir aussitôt une fois
sortis de leurs tranchées.
Le modernisme a tué le romantisme, et il le détruit toujours.
Remarque, mon cher, que tu peux raconter l’histoire de la mort de n’importe
martyre de la Seconde Intifada et que le point culminant de l’événement
n’est pas sa vie mais le moment de sa mort, sauf pour ceux qui ont été tués
par des missiles intelligents largués par des avions. On peut raconter la
vie d’Ahmed Yassin avec un romantisme excessif et absorber à l’intérieur de
soi-même la légèreté de l’esprit du cheikh. Toutefois, au moment de son
martyre, lors de son dernier combat, on ne peut le décrire en plus de dix
mots et de trente secondes, au contraire des martyrs qui sont tombés durant
des confrontations directes et des affrontements armés avec l’ennemi. Te
souviens-tu de notre conversation à propos du martyre de Louay Al-Saadi ?
Même tes remarques et ta critique concernant les paradoxes de la guerre de
2014 étaient que celle-ci avait fait de la majeure partie de la société un
public passif qui attend la mort. Tu as émis des objections contre une mort
qui n’est pas entourée d’une narration romantique. Tu sais que l’équilibre
du pouvoir entre les nations est déterminé par « l’énergie potentielle » et
« l’énergie cinétique » (une énergie écrasante). Et tu sais que l’énergie
potentielle – et sa fonction à la guerre – doit se transformer en une force
écrasante. Je crois que la possibilité de créer des narrations romantiques
autour du martyre et de l’héroïsme est l’un des plus importants éléments de
l’énergie potentielle, dans laquelle nous surpassons notre ennemi.
Nous pouvons raconter dix mille histoires romantiques sur l’héroïsme et le
martyre au cours des seules dix dernières années, des histoires qui, une
fois qu’elles ont été reprises par la société, peuvent se muer, d’une
énergie potentielle enterrée, en une énergie qui écrasera l’ennemi. Par
ailleurs, notre ennemi n’a pas plus de cinquante histoires similaires, de
2006 à nos jours (c’est-à-dire dans la même période de temps). C’est une
manifestation réelle de ce que notre professeur disait : en fait, l’ennemi
a perdu toute capacité de produire des héros.
L’ère de la postmodernité ou de la modernité liquide : il m’importe peu que
tu fasses allusion à l’une ou à l’autre. Ce qui m’importe, c’est que c’est
l’ère durant laquelle le romantisme est mort et où l’héroïsme a connu sa
fin. Et tu sais certainement que nous, les Palestiniens, nous vivons hors
de cette époque. Nous vivons dans une ère coloniale palestinienne, dans un
monde postmoderne et, ainsi donc, nous sommes toujours en mesure de
produire des narrations romantiques.
Permets-moi de m’adresser à toi ainsi qu’à notre ami poète : te
rappelles-tu la déclaration de notre ami à propos du nombre de narrations
découvertes au sein des communautés de la Palestine de 1948 et qui sont
chargées d’imagination ? Et comment ce trait disparaît dans les autres
narrations ? Tu remarqueras que les histoires tournant autour de l’héroïsme
et de la victoire sont celles qui sont emplies de fantaisies populaires et
de romantisme, comme l’histoire des graines de blé dans la poche du martyr
originaire de Kafr Kanna (2). Alors que les narrations qui reprennent les
histoires des victimes sont bâclées, rigides, lourdes et ennuyeuses et ne
sont rien de plus que des éléments de documentation vides de toute
imagination.
Et tu remarqueras aussi à quel point les histoires d’héroïsme sont des
narrations débordant de romantisme, alors que les autres, sur la condition
de victime, sont brèves. Cela, à mes yeux, peut uniquement vouloir dire que
les nations sont victorieuses quand elles renoncent au romantisme. Parfois,
après avoir admis la défaite, le parti vaincu tente de se raccrocher à ce
qui reste de son romantisme défunt et, ce faisant, que produit-il ? Nous
pouvons assister ici à la production de l’une ou l’autre sorte de fantaisie
banale, à quelque chose qui s’apparente aux surhommes que nous voyons
habituellement à Bollywood (l’industrie cinématographique indienne – NdT)
ou dans le Hollywood du milieu des années 1970 et 1980. Et je ne parle pas
des films comiques de superhéros comme Superman, Batman et Spiderman, où ce
genre d’imagination sauvage serait autorisé ; non, ce que je veux dire ici,
ce sont des œuvres comme Rambo, par exemple. Je suis entièrement convaincu
que Rambo et les films d’Arnold (Schwarzenegger – NdT) et d’autres films de
cette époque n’étaient rien de plus que de simples tentatives de sauver ce
romantisme américain que nous avons vu passé par les armes au Vietnam. Et,
ainsi donc, tous ces films, outre leur piètre qualité, ont tous un
caractère brutal, offensif et éculé et, qui plus est, ils en viennent à
s’approprier le romantisme de leur ennemi afin d’en nourrir leurs propres
narrations. Un exemple manifeste, ici, ce sont les astuces dont nous voyons
Rambo se servir au Vietnam et qui, en fait, ont été « empruntées » aux
Vietnamiens eux-mêmes.
Ou peut-être pouvons-nous regarder les films indiens, qui exagèrent en
vulgarisant l’héroïsme qu’ils mettent en scène et couvrent de ridicule des
histoires romantiques parce que – ici, je n’en suis pas tout à fait sûr –
l’imagination populaire en Inde n’a pas d’autre choix que de sauvegarder
son romantisme perdu. Pour moi, ce phénomène a trait au système de castes
que l’on trouve en Inde.
Il est utile d’insister ici sur le fait qu’une ligne ténue sépare le
romantisme de la vulgarité et qu’il existe également une ligne ténue entre
les narrations romantiques constructives et les narrations mythologiques,
lesquelles manquent de bons outils d’analyse.
Quand on s’interroge sur les martyrs de cette intifada, on ne voit que des
hommes se précipitant avec toute leur célérité et leur impétuosité, portant
leurs couteaux et leurs armes à feu, comme s’ils tentaient de se saisir de
quelque chose que nous ne pouvons voir. Ce phénomène n’est autre que le
romantisme de la guerre.
« Tel est le métier de chevalier : se révolter sans garantie. L’esprit d’un
homme n’est pas enthousiaste, mais combatif. Nous sommes des combattants et
nous ne sommes pas des boutiquiers »,
comme le dit Nikos Kazantzakis dans son roman « la liberté ou la mort ».
C’était la réponse du combattant, l’enseignant caribéen, au combattant Kambata
Ross, quand il demandait des actes fermes avant de mettre en mouvement les
bateaux, fournitures, armes et soldats russes et grecs. L’enseignant
qualifiait cet esprit de « compréhension intelligente ». Peut-être est-ce
la même chose que la « sagacité » d’Ali Shariati et c’est peut-être une
abstraction descriptive de ce qu’est le romantisme.
Et je me découvre en train de sourire quand j’accuse Nikos d’avoir emprunté
cet axiome à notre chant populaire du Walaji (3) appelé « Waw » (4). En
effet, nous disons ceci :
« Ne nous considère pas comme des étrangers, ô Waw
Nous ne vendons pas d’épices (…)
Nous sommes les protecteurs de femmes
Le jour où il y a un raid contre elles. »
Finalement, peut-être les amis qui ont vu ma colère dans ma tentative en
vue de défendre la voie des martyrs me pardonneraient-ils s’ils grattaient
la surface extérieure du romantisme du martyre et de l’héroïsme dans ma
conscience.
°°°°°
Gloire à toi, ô martyr résistant et érudit.
Le testament du martyr Basil Al-Araj :
Salutations de la part du nationalisme, de la patrie et de la libération
arabes,
Si tu lis ceci, cela veut dire que je suis mort et que mon âme est montée
vers son créateur. Je prie Dieu de pouvoir le rencontrer avec un cœur
innocent, de mon plein gré, jamais à contrecœur et libre de toute trace
d’hypocrisie. Qu’il est difficile d’écrire son propre testament… Depuis des
années, je vois ce genre de textes rédigés par des martyrs et cela me
déconcerte. Brefs et sans éloquence, ils ne satisfont pas notre brûlant
désir de réponses au sujet du martyre.
Maintenant, je suis en route vers ma mort, satisfait d’avoir trouvé mes
réponses. Quel insensé je suis ! Y a-t-il quelque chose de plus éloquent
que les actions d’un martyr ? J’aurais dû écrire ceci il y a des mois mais
ce qui m’en a empêché, c’était que cette question était pour vous, les
vivants. Pourquoi devrais-je répondre à votre place ? C’est vous qui
devriez chercher la réponse. Quant à nous, les gens des tombes, nous ne
cherchons rien d’autre que la miséricorde de Dieu.
*****
Notes
L’ataaba est une forme musicale arabe traditionnelle et chantée dans les
mariages, les festivals et d’autres occasions.
Kafr Kanna est un village palestinien de l’intérieur occupé (les terres de
1948).
De Walaja, le village natal de Basil, près de Bethléem.
« Waw » est l’avant-dernière lettre de l’alphabet arabe et constitue la
seule lettre du mot « wa », qui signifie « et ».